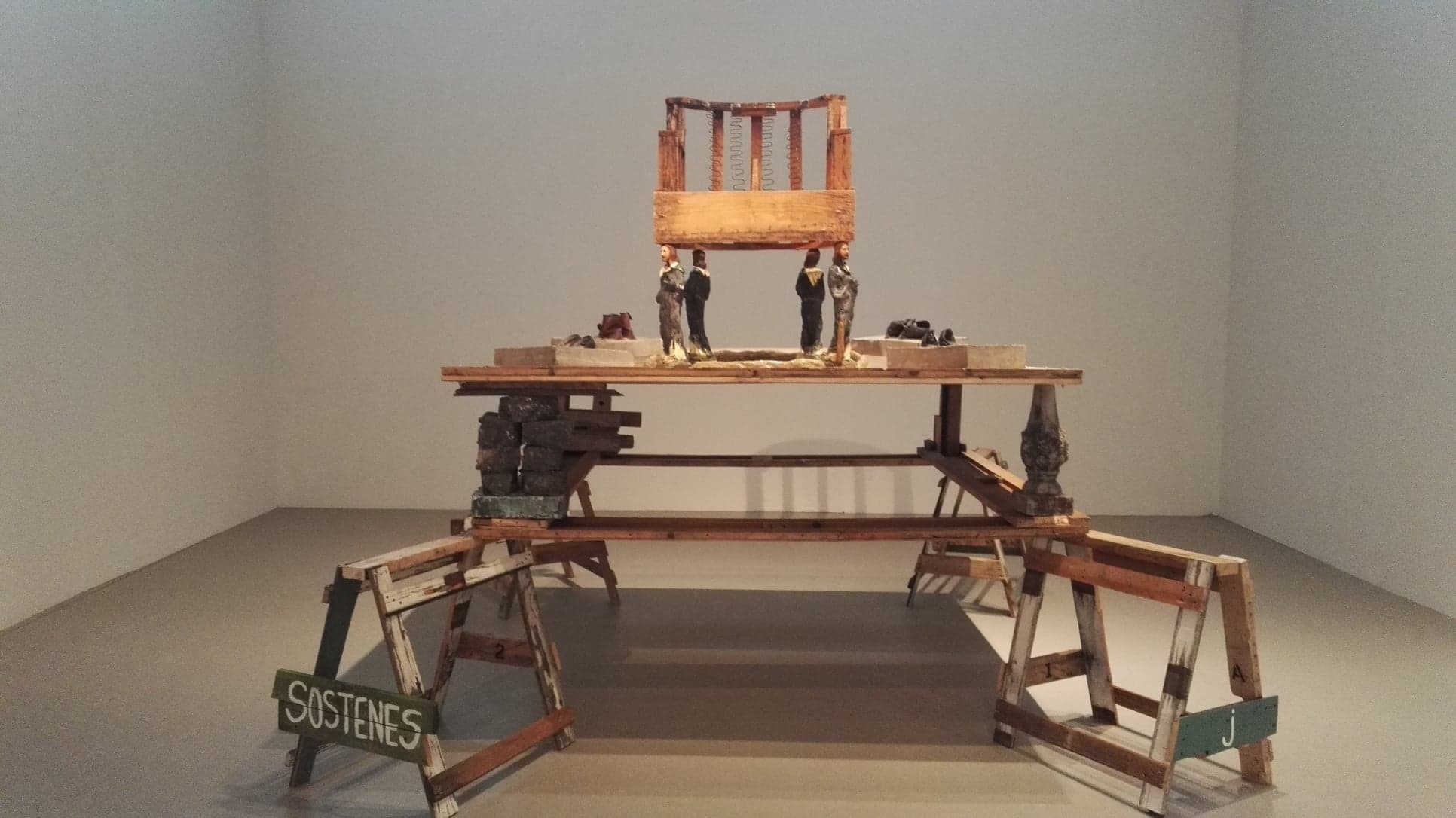Certaines personnes me demandent si je travaille toujours. A mon grand soulagement, oui. Parce que j’ai la chance de sortir de chez moi tous les matins et de profiter du printemps tout en pédalant sur des routes quasi désertes. Mais surtout parce que malheureusement, les autres pathologies ne s’arrêtent pas pendant l’épidémie de coronavirus. Nos patients psychiatriques continuent d’avoir besoin de nous. En ville, à l’hôpital et en prison.
Dans notre service, tout l’enjeu est de maintenir les soins pour les patients les plus fragiles et les urgences, et d’annuler les consultations des patients bien stabilisés pour minimiser les contacts sociaux et ainsi limiter la transmission. Car nous le savons, le risque ici, c’est nous. Nous qui, une fois n’est pas coutume, serons les loups dans la bergerie. Certaines personnes détenues l’ont bien compris et nous évitent. Ma collègue médecin généraliste notait que , malgré le maintien de toutes ses consultations pour l’instant, les demandes se faisaient plus rares, par peur pensait-elle, de venir voir des personnes venant de l’extérieur.
Selon les épidémiologistes, du fait du confinement inhérent aux prisons, le pic épidémique devrait y arriver avec deux semaines de retard. C’est un temps que nous devons mettre à profit pour nous organiser, car en revanche, la promiscuité promet une contagion rapide.
Heureusement, de notre fonctionnement habituel nous avons aussi sauvegardé ce qui à mon sens est une des forces de la psychiatrie : notre capacité à réfléchir ensemble, chacun de puis sa place mais faisant partie de la même équipe. Nous avons donc gardé nos sacro-saintes réunions que nos collègues d’autres disciplines, nous envient en se cachant derrière leurs plaisanteries moqueuses (en petit comité et en respectant les distances de sécurité bien entendu)
Ainsi chaque jour, une cellule de crise suit l’évolution des directives de notre hôpital de rattachement et fait remonter les questionnements spécifiques à notre exercice en milieu pénitentiaire, parfois un peu oubliés.
L’UCSA (service ambulatoire de médecine générale) et l’administration pénitentiaire travaillent à la mise en place d’une zone d’hébergement pénitentiaire pour accueillir les détenus infectés, et en collaboration avec eux, nous réfléchissons à la façon dont nous y interviendrons pour les soins psychiatriques qui seraient nécessaires. Nous nous préparons à remplacer nos collègues qui ne pourraient plus travailler, en espérant ne pas devoir abandonner totalement nos patients.
Pour l’instant tout est calme et le Ministère de la Justice, probablement instruit par les émeutes survenues dans les prisons italiennes, a pris des mesures humanistes et de bon sens pour que cela le reste. Ainsi, pour pallier à la suppression des visites familiales, un crédit de téléphone a été attribué à chaque détenu.
Pour l’instant donc tout est calme, mais ce calme nous laisse inquiets, attendant la tempête. Il est à craindre que cette situation n’entraîne, outre les problèmes sanitaires liés au virus lui-même, de vraies décompensations psychiatriques liées au stress et au relâchement des soins. Mais aussi de nombreuses réactions plus ou moins rationnelles, à l’image de celles observées chez nos concitoyens à l’extérieur.
Enfin, notre inquiétude va aussi à ceux de nos patients devant sortir de détention dans les prochains jours ou semaines. Certains n’ont plus d’hébergement du fait de la fermeture des structures qui devaient les accueillir. Les associations d’aide aux plus précaires ont drastiquement réduit leurs interventions. Quant aux CMP (centres médico-psychologiques, dédiés aux soins psychiatrique en ville), ils reportent eux aussi leurs rendez-vous.
Il nous faut alerter sur le risque de laisser la population précaire exposée à bien des dangers. Il y bien sur le virus, qui représente un danger tant sur le plan individuel, les personnes sans abri étant souvent en mauvais état général et plus à risque de faire de formes graves, que sur le plan collectif. Nous n’avons pas intérêt à ce que subsiste, lorsque les mesures de confinement seront levées, dans les squats, échappant à tous les radars, une circulation du virus. Mais il y aussi la pauvreté et le manques de soins, qui créeront immanquablement des dommages collatéraux.
Espérons que les propositions entendues ici et là de réquisitionner les hôtels désertés pour accueillir les personnes sans abri trouvent un écho favorable, témoignant ainsi que cette période troublée peut aussi être celle d’une solidarité qui n’oublie personne.
Pour aller plus loin, je vous invite à lire :
- le communiqué de presse de la Fédération des Addictions https://www.federationaddiction.fr/addiction-precarite-et-confinement-ne-laissons-pas-de-failles-dans-la-protection-commune/
- l’article de France 3- Centre Val de Loire : https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/coronavirus-il-y-aura-beaucoup-morts-services-psychiatriques-tension-1804142.html?fbclid=IwAR1MuQ1n-QHFVIISYZ8jsCUFs7x0sjsoRCerrgNjTFaQ4SdIN5j14xR3Dhw